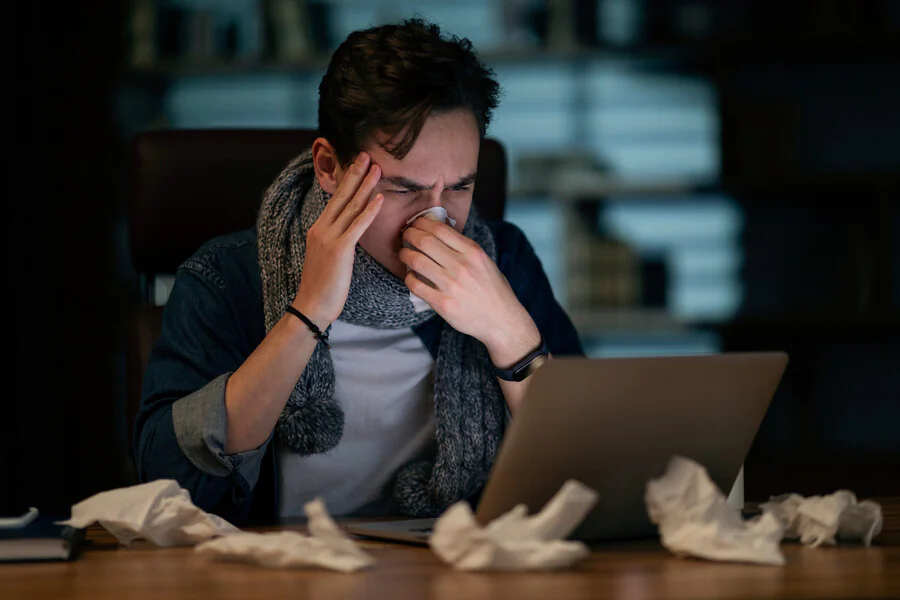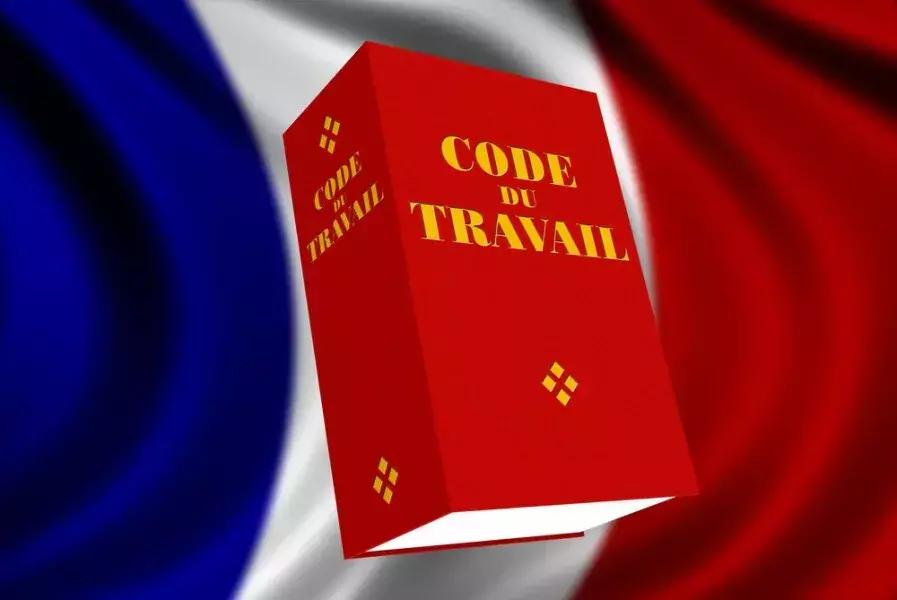La possibilité de résiliation constitue, pour l'employé en CDD, une liberté fondamentale inhérente à l'exécution de sa convention de travail . Lorsque ce choix intervient cependant au cours d'une interruption, la question soulève des enjeux juridiques et sociaux particuliers, aussi bien sur le plan du consentement que sur celui du formalisme. Découvrez dans ce guide complet, tout ce que vous devez savoir sur ce que dit la loi concernant la démission en arrêt maladie.
Démissionner en arrêt maladie : quelles sont les implications légales ?
Il n'existe, à ce jour, aucune disposition légale interdisant au salarié de rompre son contrat durant son arrêt maladie , qu'il s'agisse d'un renoncement pour accident de travail, pour affection d'origine non professionnelle ou trouble professionnel. L'article L1231-1 du Code du travail rappelle que : « Le contrat de travail à durée déterminée peut être rompu sous l'impulsion du travailleur, qui notifie sa démission à son employeur ».
Aucune condition relative à l'aptitude physique de l'employé n'est prévue pour restreindre cette liberté. Dès lors, ce dernier conserve la faculté de mettre fin à son engagement par une renonciation.
Les conditions de validité de cette procédure
Si le salarié est libre de démissionner à tout moment pendant son interruption, la validité de son choix suppose que son consentement soit libre et éclairé. Ceci, conformément aux principes généraux du droit civil applicables en matière contractuelle. En jurisprudence constante, le désistement n'est en effet valable que s'il procède d'une volonté manifeste, sérieuse et non équivoque du salarié.
Ainsi, une résignation exprimée sous la pression ou dans un contexte d'altération temporaire du discernement ou de trouble psychique pourrait être requalifiée en rupture abusive. Elle fait également l'objet d'une contestation devant le conseil des prud'hommes.
Par ailleurs, la législation du travail ne prévoit aucun formalisme officiel en matière de désistement. Pour sécuriser la démarche et éviter tout contentieux, il est cependant vivement conseillé de la formuler par écrit, datée et signée, puis adressée à son entreprise. Ceci doit se faire idéalement par lettre recommandée avec accusé de réception.
Qu'en est-il du préavis ?
À moins d'un accord précis avec sa société, tout employé démissionnaire ne doit pas quitter son emploi du jour au lendemain. Il se doit de respecter une période de préavis. La manière dont ce préavis est appliqué dépend toutefois de l'origine de l'interruption. En cas de trouble non professionnel, l'annulation ne suspend pas le préavis du salarié et le contrat prend fin à la date initialement prévue. S'il s'agit d'un accident de travail ou d'une affection professionnelle, le préavis est suspendu et ne reprendra qu'après la fin de l'arrêt.
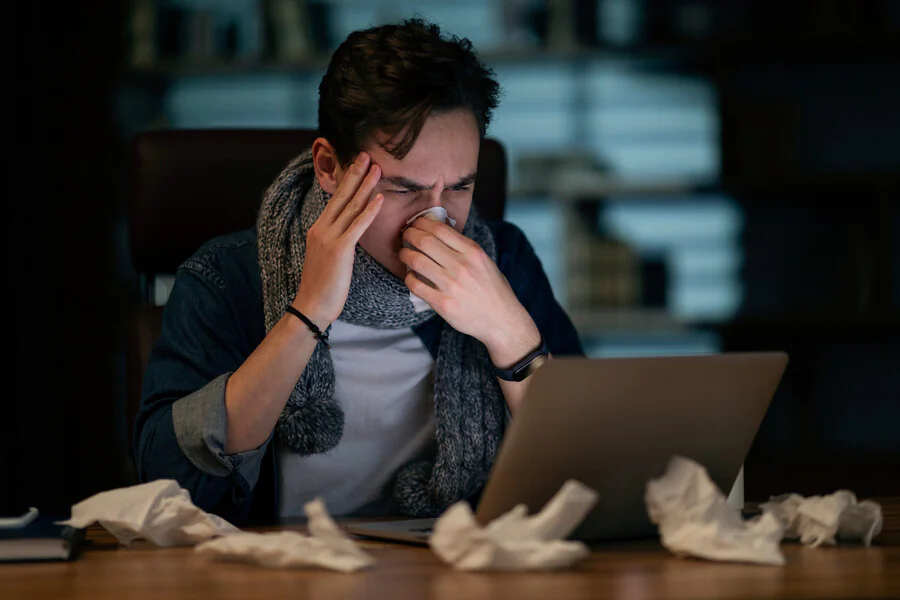
Peut-on toucher une indemnité après une démission en arrêt maladie ?
Le choix de résilier son CDD pendant un arrêt doit être mûrement réfléchi. Au-delà des effets contractuels immédiats, cette situation comporte des effets non négligeables sur le maintien des indemnisations journalières, mais aussi sur l'accès à la couverture sociale et aux droits au chômage. Il est donc essentiel de bien comprendre l'impact de cette résolution avant de se lancer, afin d'éviter toute perte de ses prérogatives.
Quels sont les droits au chômage après une démission en arrêt maladie ?
Lorsque vous résiliez votre CDD pendant une interruption de travail et que l'annulation de votre engagement intervient avant la fin de cette période, vous pouvez continuer à bénéficier des indemnités journalières. Le versement de ces indemnités est maintenu sur une durée de 12 mois après le terme de votre contrat de travail sous réserve de respecter certaines conditions.
En France, pour bénéficier de ce maintien, vous devez en effet remplir les critères suivants :
- L'arrêt doit avoir débuté avant la fin de l'accord de travail,
- La résiliation doit être considérée comme légitime,
- Le salarié en CDI doit avoir cotisé un nombre d'heures suffisant au régime de la Sécurité sociale.
Concernant l'indemnité compensatrice de préavis, si vous êtes à l'origine d'une requête de dispense de préavis, vous ne pourrez en bénéficier. Si, au contraire, votre entreprise est à l'instigation de la dispense, elle sera dans l'obligation de vous verser une indemnité correspondant à la rémunération que vous auriez dû percevoir si vous aviez effectué votre préavis. Retenez au passage que dans le cas d'un incident non professionnel, votre embaucheur est en mesure de déduire le montant de vos indemnités journalières de l'indemnité compensatrice.
Qu'en est-il de l'allocation de retour à l'emploi (ARE) ?
En principe, une résiliation n'ouvre pas droit à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), sauf dans les limites prévues par la réglementation de l'UNEDIC. Un désistement pendant un arrêt n'entre généralement pas dans cette configuration, sauf s'il est justifié par un motif légitime. Par conséquent, le salarié ne bénéficiera pas d'allocations au chômage. Il a toutefois la possibilité de solliciter un réexamen de sa situation au bout de 121 jours sans emploi, dans le cadre d'un dispositif spécifique prévu par l'Assurance maladie.
La protection complémentaire : prévoyance et mutuelle
La suppression d'un contrat de travail met fin aux garanties collectives, sauf lorsque le salarié remplit les conditions de portabilité prévues par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale. Cette portabilité offre à l'employé la possibilité de bénéficier des garanties de la mutuelle et de la prévoyance pendant 12 mois maximum, sans cotisation supplémentaire, sous réserve d'une prise en charge par l'Assurance maladie.
Peut-on revenir sur sa démission lorsqu'on est en arrêt maladie ?
La démission constitue un acte unilatéral par lequel l'employé annonce de façon claire et non équivoque son envie de mettre fin à son accord de travail à durée déterminée. En droit du travail, cette expression de détermination, une fois manifestée, ne doit en principe pas être rétractée unilatéralement, même si elle intervient pendant un arrêt.
La jurisprudence constante de la Cour de cassation rappelle que la résiliation, dès l'instant où elle a été librement et clairement notifiée, lie définitivement le salarié, sans possibilité de revenir sur son jugement, sans l'accord de son employeur. Ce principe s'applique à tous les salariés, quel que soit le contexte, y compris en situation d'arrêt. Dès lors que l'employé était en état de discernement et que son consentement n'a pas été vicié, il n'y a pas de retour en arrière possible.

Dans quelles situations peut-on revenir sur une démission ?
Une exception notable peut toutefois être soulevée lors de cette procédure. Si l'employé parvient à démontrer que sa résolution de démissionner a été prise dans un contexte de trouble psychologique avéré (sentiment dépressif, pression morale, situation de détresse liée au traitement médical…) la validité de son choix peut dans ce cas être contestée.
Dans ce cas, l'intéressé a la possibilité de saisir le conseil des prud'hommes pour obtenir l'annulation de la rupture de contrat, au motif d'un vice de consentement. La charge de la preuve incombe cependant à l'employé. Ce sera à lui de produire les éléments médicaux circonstanciés ou de prouver que son choix a été fait dans un moment d'altération de son jugement.
Nos conseils avant de prendre une décision de démission
Dans le cadre d'une abrogation de contrat pendant un arrêt maladie, il est fortement recommandé d'agir prudemment. Vous devez veiller à protéger vos intérêts sociaux et juridiques, et ce, à chaque niveau de votre démarche. Avant toute entreprise, consultez un professionnel de santé (psychiatre ou médecin traitant). Ce dernier pourra évaluer précisément votre capacité à avoir un jugement éclairé, en prenant en compte votre condition physique et psychologique.
Si vous souhaitez renoncer de manière non équivoque à votre contrat, prenez le temps de rédiger un courrier simple, précis, daté et signé. Il est déconseillé de formuler votre requête oralement ou de manière ambiguë. Adressez une lettre recommandée avec accusé de réception comprenant les éléments suivants : la mention explicite de l'envie de résilier votre CDD, le jour d'effet envisagé de la scission, l'absence de condition ou d'hésitation.
Évaluer aussi les répercussions de votre acte avec un professionnel. Prenez attache avec un avocat en annulation conventionnelle pour vous aider à évaluer la solidité de votre détermination juridique, vous informer sur les alternatives, et élaborer une stratégie de départ sécurisé.
Questions fréquentes sur la démission pendant un arrêt maladie
Voici quelques réponses aux interrogations habituelles sur l'annulation de contrat de travail lors d'un arrêt maladie.
Un employeur peut-il refuser une démission ?
Non, le renoncement au contrat pendant cette période reste un droit du salarié. Votre entreprise n'a donc pas la possibilité de s'y opposer.

Combien de temps dure le préavis en arrêt maladie ?
Tout travailleur démissionnaire est dans l'obligation de respecter un délai de préavis. Ce moment varie de 1 à 3 mois selon les dispositions définies par la convention collective.
Comment donner sa démission en étant en arrêt maladie ?
Pour donner votre démission, vous devez rédiger une lettre recommandée avec accusé de réception, et l'adresser à votre société. Ce document doit contenir certaines mentions importantes comme votre volonté indéfectible de rompre votre contrat de travail, le moment envisagé de la scission, ainsi que l'absence d'hésitation.
Que retenir sur la démission en arrêt maladie ?
Bien que la démission en arrêt maladie soit possible, cette procédure exige une approche mesurée, rigoureuse, et encadrée, tant sur le plan médical que formel. Un jugement précipité, fait dans un moment de trouble ou de fragilité, entraîne souvent des répercussions graves et souvent complexes à réparer. N'hésitez pas à vous entourer de professionnels juridiques pour bénéficier de conseils précieux lors de votre démarche.